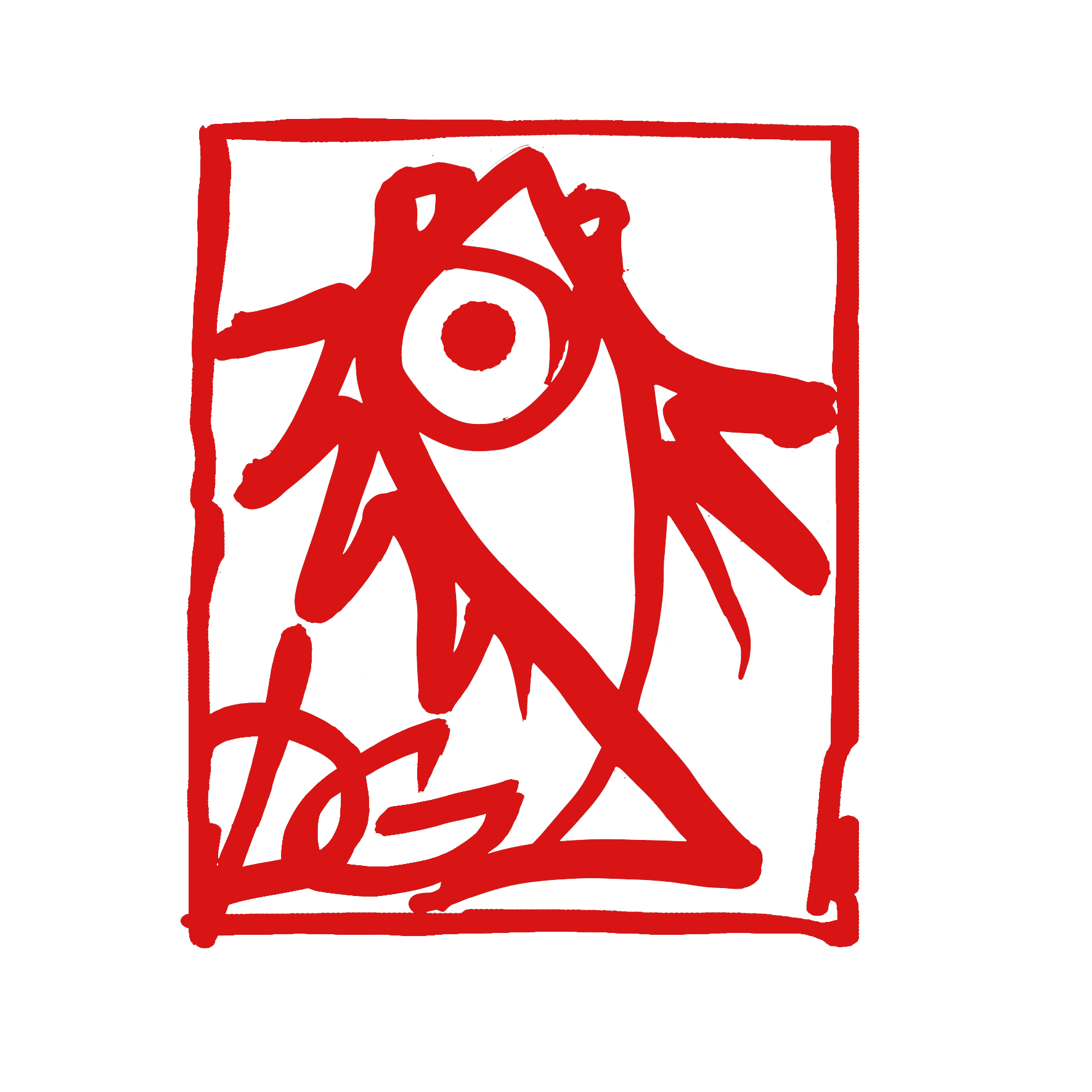point de vue, Bernard Prouteau
Dans le noir, la page blanche n’est pas inquiétante. On peut faire comme si elle n’était pas là. Mais que la lumière la révèle, et aussitôt elle l’arrête et la renvoie. Ou bien elle l’absorbe et la diffuse. C’est selon. Mais, toujours, elle ouvre une porte invisible sur un vide infini, comme une attente… Et la béance est double : grande ouverte sur le réel en même temps que sur l’imaginaire…
Léger vertige...
Elle n’est pas pressée, la page blanche, elle peut attendre. Très longtemps. Elle se fout même un peu des regards qui la fixent ou qui l’effleurent. C’est celui qui a l’intention d’y inscrire des signes qui se fait un sang d’encre. Il croit qu’elle s’impatiente, qu’elle l’attend, lui, le poète, le peintre, le compositeur, le dessinateur, le romancier, le calligraphe, l’architecte, le graphiste, le passeur… Passeur de sens, passeur de rêve, passeur de vie, artisan des signes qui a pour mission de faire en sorte que la page ne soit plus blanche.
Pour qu’alors elle disparaisse derrière les signes qui, eux, disent et montrent.
Didier Gauduchon est graphiste. C’est son métier. Un métier qu’il aime au point de le mettre en scène. En autoportrait du graphiste graphant. Pas le genre d’autoportrait de l’artiste qui prend la pose et se reproduit, nature morte de lui-même, pour l’éternité. Un autoportrait qui prend les pinceaux pour revivre, sur scène, les gestes par lesquels il fait naître les signes. Pour raconter, en grand format, son affrontement quotidien avec la page blanche, dans un fascinant jeu de cache-cache où rien n’est caché, un jeu de miroir qui ne renvoie jamais le reflet attendu… Sur la feuille vierge, géante, démultipliée pour former un mur où rien n’est interdit, surtout pas d’afficher.
C’est d’abord l’ombre qui peint derrière la page, grande et floue, qui se concentre et se précise quand elle s’approche et parfois se dédouble. Bruissant des frottements du pinceau, le papier se couvre de points, de traits, de courbes, de taches, de couleurs, qui deviennent lettres, mots, objets, plantes, animaux, paysages, pensées, sentiments, émotions. Et comme pour éviter que tout cela ne déborde, l’ombre trace une bordure noire encadrant le motif : fragile limite qui rassure tout autant qu’elle invite à la transgression.
Page après page, des histoires palpitantes se racontent, délivrées par bribes dans un temps et un espace qui échappent à notre logique. Nous sommes dans le temps et l’espace où vivent les signes, où les formes s’installent, ici ou là, et se transforment en fonction de ce qui se passe autour d’elles. Un rond blanc immaculé se cerne de noir, creusant un trou qui deviendra le O du mot Oui, ou du mot extraOrdinaire, ou qui s’enroulera en spirale ubuesque pour devenir un Q, le double Q de QuelQue chose. Un rond dont les aventures s’enchaînent, d’histoire en histoire, de mot en mot, de nOn à tOi, de trou en soleil, d’assiette en visage, de lune en oiseau. Ainsi se croisent les vies des lignes et des taches pour dessiner des forêts, des corps de femme, des mots d’amour, des pensées intimes. Comme un film en train de se faire, sur des écrans que traversent la peinture, la lumière, la lame d’un cutter ou un bras armé d’un pinceau. Des écrans qui peuvent se couvrir d’un échiquier de visages amis, se voiler d’un rideau noir ou s’illuminer d’images vidéo où deux enfants marchent vers la mer. Entraîné dans les indices d’une mystérieuse énigme, le spectateur est convié à parcourir les imprévisibles métamorphoses d’un apparent désordre en train de s’organiser, dans un suspense que résout un coup de théâtre où le sens se délivre comme une révélation.
C’est donc cela que Didier Gauduchon voulait nous montrer… Ce avec quoi il a comblé le vide, recouvert la page blanche : ces mots blancs sur fond noir (on pense à Ben), ces motifs qui se répètent (on pense à « suppport-surface »), ces portraits colorés (on pense à Warhol), le tout cerné d’un filet noir (on pense à Alechinsky), ces spirales, ces couleurs vibrantes, cette calligraphie modeste et majuscule, ces collages dadaïstes (on pense à lui, bien sûr).
C’est donc cela qu’il voulait nous raconter… Ces aveux, ces confidences et ces déclarations d’amour à son métier, aux mots, aux gestes, à la femme aimée, aux enfants, aux amis, à la nature, au plaisir qui, comme la lumière et la peinture, comme le graphiste et son ombre, ne cessent de traverser la surface sensible, d’y rebondir ou d’y chercher une place, de s’y répandre langoureusement ou de s’y écraser comme un moucheron sur un pare-brise.
La scène ouvre alors un autre espace où se joue la question de la place du graphiste par rapport à son travail, dans un incessant va-et-vient entre l’arrière et l’avant, entre le verso et le recto de la page qu’il traverse ou qu’il contourne, dans la solitude du geste de création comme dans le regard du public. Corps, coeur et esprit, traversés ensemble par le message en quête d’une nouvelle forme, lisible, informative, séduisante, originale, esthétique… Corps, coeur et esprit qui laissent un peu d’eux-mêmes entre les lignes, dans les mots et dans les formes, comme pour rappeler, s’il en est encore besoin, que « le style, c’est l’homme ».
Ce que confirme, à l’évidence, la bande-son qui installe une autre dimension du temps et de l’espace, celle des travaux et des jours, celle des mille bonheurs quotidiens, qui englobe et qui nourrit le temps de la création. Car, dans chaque geste de Didier Gauduchon, il y a des chants d’oiseaux, le bruit de la pluie, l’ambiance de la cuisine où un repas se prépare, le cliquetis des machines d’imprimerie, les voix des proches et les mots des amis, la musique... De la vie, de l’amour.
Léger vertige...
Elle n’est pas pressée, la page blanche, elle peut attendre. Très longtemps. Elle se fout même un peu des regards qui la fixent ou qui l’effleurent. C’est celui qui a l’intention d’y inscrire des signes qui se fait un sang d’encre. Il croit qu’elle s’impatiente, qu’elle l’attend, lui, le poète, le peintre, le compositeur, le dessinateur, le romancier, le calligraphe, l’architecte, le graphiste, le passeur… Passeur de sens, passeur de rêve, passeur de vie, artisan des signes qui a pour mission de faire en sorte que la page ne soit plus blanche.
Pour qu’alors elle disparaisse derrière les signes qui, eux, disent et montrent.
Didier Gauduchon est graphiste. C’est son métier. Un métier qu’il aime au point de le mettre en scène. En autoportrait du graphiste graphant. Pas le genre d’autoportrait de l’artiste qui prend la pose et se reproduit, nature morte de lui-même, pour l’éternité. Un autoportrait qui prend les pinceaux pour revivre, sur scène, les gestes par lesquels il fait naître les signes. Pour raconter, en grand format, son affrontement quotidien avec la page blanche, dans un fascinant jeu de cache-cache où rien n’est caché, un jeu de miroir qui ne renvoie jamais le reflet attendu… Sur la feuille vierge, géante, démultipliée pour former un mur où rien n’est interdit, surtout pas d’afficher.
C’est d’abord l’ombre qui peint derrière la page, grande et floue, qui se concentre et se précise quand elle s’approche et parfois se dédouble. Bruissant des frottements du pinceau, le papier se couvre de points, de traits, de courbes, de taches, de couleurs, qui deviennent lettres, mots, objets, plantes, animaux, paysages, pensées, sentiments, émotions. Et comme pour éviter que tout cela ne déborde, l’ombre trace une bordure noire encadrant le motif : fragile limite qui rassure tout autant qu’elle invite à la transgression.
Page après page, des histoires palpitantes se racontent, délivrées par bribes dans un temps et un espace qui échappent à notre logique. Nous sommes dans le temps et l’espace où vivent les signes, où les formes s’installent, ici ou là, et se transforment en fonction de ce qui se passe autour d’elles. Un rond blanc immaculé se cerne de noir, creusant un trou qui deviendra le O du mot Oui, ou du mot extraOrdinaire, ou qui s’enroulera en spirale ubuesque pour devenir un Q, le double Q de QuelQue chose. Un rond dont les aventures s’enchaînent, d’histoire en histoire, de mot en mot, de nOn à tOi, de trou en soleil, d’assiette en visage, de lune en oiseau. Ainsi se croisent les vies des lignes et des taches pour dessiner des forêts, des corps de femme, des mots d’amour, des pensées intimes. Comme un film en train de se faire, sur des écrans que traversent la peinture, la lumière, la lame d’un cutter ou un bras armé d’un pinceau. Des écrans qui peuvent se couvrir d’un échiquier de visages amis, se voiler d’un rideau noir ou s’illuminer d’images vidéo où deux enfants marchent vers la mer. Entraîné dans les indices d’une mystérieuse énigme, le spectateur est convié à parcourir les imprévisibles métamorphoses d’un apparent désordre en train de s’organiser, dans un suspense que résout un coup de théâtre où le sens se délivre comme une révélation.
C’est donc cela que Didier Gauduchon voulait nous montrer… Ce avec quoi il a comblé le vide, recouvert la page blanche : ces mots blancs sur fond noir (on pense à Ben), ces motifs qui se répètent (on pense à « suppport-surface »), ces portraits colorés (on pense à Warhol), le tout cerné d’un filet noir (on pense à Alechinsky), ces spirales, ces couleurs vibrantes, cette calligraphie modeste et majuscule, ces collages dadaïstes (on pense à lui, bien sûr).
C’est donc cela qu’il voulait nous raconter… Ces aveux, ces confidences et ces déclarations d’amour à son métier, aux mots, aux gestes, à la femme aimée, aux enfants, aux amis, à la nature, au plaisir qui, comme la lumière et la peinture, comme le graphiste et son ombre, ne cessent de traverser la surface sensible, d’y rebondir ou d’y chercher une place, de s’y répandre langoureusement ou de s’y écraser comme un moucheron sur un pare-brise.
La scène ouvre alors un autre espace où se joue la question de la place du graphiste par rapport à son travail, dans un incessant va-et-vient entre l’arrière et l’avant, entre le verso et le recto de la page qu’il traverse ou qu’il contourne, dans la solitude du geste de création comme dans le regard du public. Corps, coeur et esprit, traversés ensemble par le message en quête d’une nouvelle forme, lisible, informative, séduisante, originale, esthétique… Corps, coeur et esprit qui laissent un peu d’eux-mêmes entre les lignes, dans les mots et dans les formes, comme pour rappeler, s’il en est encore besoin, que « le style, c’est l’homme ».
Ce que confirme, à l’évidence, la bande-son qui installe une autre dimension du temps et de l’espace, celle des travaux et des jours, celle des mille bonheurs quotidiens, qui englobe et qui nourrit le temps de la création. Car, dans chaque geste de Didier Gauduchon, il y a des chants d’oiseaux, le bruit de la pluie, l’ambiance de la cuisine où un repas se prépare, le cliquetis des machines d’imprimerie, les voix des proches et les mots des amis, la musique... De la vie, de l’amour.